Objet non identifié : que sont les Black Studies et d’où ça vient ?
Les Black Studies sont “un champ de recherches d’études” (définition de l’Institut des mondes africains, CNRS, Paris). Nées aux Etats-Unis, le terme est choisi à l’initiative d’étudiants de l’Université d’Etat de San Francisco, quatre ans après la proclamation du Civil Rights Act (1964). C’est donc en 1968, au coeur des révolutions étudiantes et nationalistes, que les Black Studies sont officiellement reconnues comme un champ disciplinaire et obtiennent un département dans les universités aux Etats-Unis.

5 Novembre 1968 : quatre étudiants de la Black Students Union (BSU) font pression pour l’ouverture d’un département pour l’enseignement des Black Studies, avec une liste de requêtes au Président de l’établissement universitaire. Avec à leur tête Nathan Hare (sociologue de l’université de Chicago, engagé dans le mouvement Black Power propulsé par les Black Panthers, qui met au devant de la scène les mouvements politiques, culturels et sociaux Noirs aux Etats-Unis entre les années 1960 et 1970). Le département devait avoir pour vocation “d’introduire l’étude systématique de l’histoire de la culture et des expériences de la communauté noire américaine dans les universités, sur le principe du mouvement Black Power, qui permet de réattribuer aux afro-américains leurs contributions à l’histoire” écrit Caroline Rolland-Diamond, Maîtresse de conférences en histoire américaine à l’Université Paris Ouest Nanterre, dans son article Sociohistoire des Black Studies Departments (22 Juin 2012). (source :https://journals.openedition.org/ideas/266#tocto1n1).

Des étudiants portes-parole de la BSU (Black Student Union), au département des Black Studies, tiennent ici une conférence pour amplifier l’impact de leur requêtes au Président de l’université en 1968.
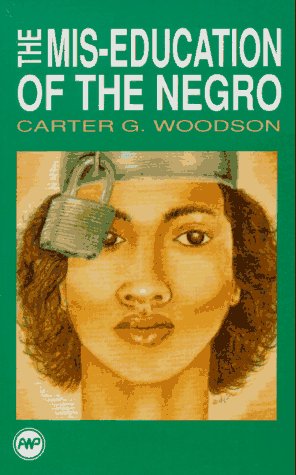
Visuel de la couverture du livre de Carter G. Woodson, 1924
Peu développées ou peu nommées en France, les Black Studies (que l’on peut aussi entendre sous le nom de “African-American Studies” ou “African Studies”, parce que l’histoire de la discipline a évoluée et que sa définition est difficile à mettre en place dans un contexte de répression) sont présentes sans l’être. Un nombre conséquent d’universitaires en France travaillent sur les questions liées à la “Race”, à la “Blackness” ou au lien historique, culturel et politique entre le pays France et le continent Afrique, ou encore sur les liens entre les continents africain et européen, sans pour autant être regroupés sous un seul et même dénominateur commun : un département d’étude qui serait celui des Black Studies (il existe un équivalent à l’Institut des Mondes Africains (IMAF) au sein du CNRS mais pas de subdivisions ou départements spécialisés).
Les “Études Noires” en France
Le mouvement de la Négritude, porté par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran-Damas dans les années 1930, pourrait être vu et pensé aujourd’hui comme un avant-gardisme des Black Studies car la Négritude est un acteur au même moment que l’émergence de la pensée de Woodson en 1926 pour plus de représentation Noire. Cette prise de parole et de position politique, partant d’un courant poétique littéraire, est très engagée dans l’anticolonialisme. Les revendications de la Négritude sont celles d’une valorisation de l’ “ensemble des vertus du monde noir, des qualités de la civilisation négro-africaines” (Léopold Sédar Senghor, dans la revue Les Questions Françaises, 21 décembre 1966, p.6, coll. 5).
 Image provenant du site This Is Africa : article Forgotten Trailblazers: The “Mères” of the Négritude Movement , By Renee Edwige Dro on May 3, 2017 ; reprenant un visuel du Journal L’Etudiant Noir créé par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon- Gontran Damas. (Source : https://thisisafrica.me/forgotten-trailblazers-meres-negritude-movement/)
Image provenant du site This Is Africa : article Forgotten Trailblazers: The “Mères” of the Négritude Movement , By Renee Edwige Dro on May 3, 2017 ; reprenant un visuel du Journal L’Etudiant Noir créé par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon- Gontran Damas. (Source : https://thisisafrica.me/forgotten-trailblazers-meres-negritude-movement/)
Les mouvements et champs disciplinaires décoloniaux et postcoloniaux, amorcés par l’étude d’Edward Saïd, dans L’Orientalisme (1977), sont suivis par la présence du champ des Cultural Studies, cette fois importées du Royaume-Uni (1960). Cette longue histoire de la construction d’une discipline n’est toujours pas considérée en France comme une nécessité. FranceCulture, dans son émission La Fabrique de L’Histoire, le 25 Janvier 2018 aborde le sujet “Des Black Studies en Europe ?” et interroge la pertinence de l’ ”étiquette” et du nom de ce champ disciplinaire, en France et en Europe, par rapport au contexte États-Uniens. Le nom fait-il peur ? Il semble que l’on ne veuille pas associer le contexte français au contexte américain, peut-être parce que les violences et le racisme aux Etats-Unis sont très prononcés et explicitement présents.
La question n’est toujours pas résolue le 6 Juin 2019 lorsque l’émission Chez Moix de la chaîne TV Paris Première aborde la “ Question identitaire : une obsession française ?”. Maboula Soumahora, universitaire franco-ivorienne, fondatrice du Black History Month en France (association existant depuis 2012 en France), est interrogée par le présentateur sur son identité à travers son physique, sa couleur de peau. Elle défend que nous sommes éduqués en Europe et aux Etats-Unis à voir les couleurs, que l’héritage de l’esclavage et de la colonisation a “formaté” nos regards. La question posée : “mais qu’est-ce que ça veut dire d’être blanc ou noir ?”, rappelle la mini-série que Netflix vient de sortir sur sa plateforme, When They See Us, où quatre jeunes garçons sont incriminés sans preuves parce qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, et certainement parce qu’ils sont Noirs. La même question y est posée : qu’est-ce que cela veut dire d’être Noir ? Les Black Studies pourraient peut-être y répondre…

Visuel de la série When They See Us (Dans leur regard en VF), produite par Netflix. Sortie le 31 Mai 2019 sur la plateforme.
Dans l’émission de TV Paris Première, Maboula Soumahora défend que c’est une question de construction culturelle et de perception historique, “être traité comme”, à partir d’une apparence. Ce à quoi répond Barbara Lefebvre, très offusquée, que l’on ne sait pas si elle est blanche, en vérité, et que c’est pour cela qu’on ne doit pas pointer du doigt les couleurs (ce qu’elle fait cependant plus tard en opposant Barack Obama, métis, à la couleur Noire). Mais on croyait que les couleurs ne comptaient pas ? C’est le propre de ce paradoxe : qu’est-ce qu’une couleur veut dire ? Elle dit en fait malheureusement beaucoup encore aujourd’hui, sur la place et les droits de chacun dans nos sociétés.
Le travail fourni pour l’étude d’un passé qui n’est qu’à l’amorce d’un début de reconnaissance en France nous pousse à penser qu’un lieu, une discipline, des espaces de recherches physiques et mentaux sont nécessaires pour déconstruire les représentations coloniales et esclavagistes toujours présentes à certains égards, dans le quotidien de tous. Pourquoi est-il si difficile de faire émerger les Black Studies en France ? Peut-être parce qu’on a peur que la violence du racisme Etats-Uniens soit plaquée sur le contexte français. Mais si l’on veut éviter de lisser les identités, de les cacher et de les invisibiliser, déconstruire les préjugés et les regards faussés, ne serait-il pas préférable de laisser exister les Black Studies en France, plutôt que d’entériner des représentations passéistes ?

Une journée d’étude a été consacrée à l’étude de la (non-)présence des Black Studies en France le Vendredi 28 Juin 2019 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (105 Boulevard Raspail, 75006, Paris).
Nous avons rencontré deux des étudiantes à l’initiative de cette rencontre importante pour les acteurs-chercheurs (et artistes, car il y en avait !) qui travaillent sur ces questions : Ingrid Chateau et Guita Nilavannane. Elles nous ont partagé leur parcours, personnel et professionnel, ce qui les mènent à ces interrogations politiques et sociales, et nous expriment leur point de vue :
« Pourquoi et comment pensez-vous que les Black Studies pourraient se développer en France, par rapport à son propre contexte historique, différent de celui des Etats-Unis ? »
IC : « Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais j’ai trouvé l’opportunité de parler des questions raciales avec des personnes qui étudiaient le genre, et qui étaient très au courant des questions raciales. Cela a trotté dans ma tête et je me suis dit qu’il y avait des choses à faire, qu’il faut qu’on aille chercher par nous mêmes.
On a besoin de formaliser les choses. On ne dit pas qu’aucun professeur n’en parle, mais dans la façon dont c’est conçu et abordé, on trouvait que ce n’était pas suffisamment clair. On nous parle de la neutralité axiologique, mais quand on étudie les Cultural Studies, on explique que finalement les point de vue sont situés et ce que tu produis en terme de savoir est proche, que la distance est perméable. Lorsque tu fais de la recherche, c’est très important de savoir ça, sinon à quel moment est-ce que tu le penses et le construits ? Ce n’était pas suffisant, il n’y a pas de séminaire là-dessus. C’est cela qu’il nous manque.
Les sciences sociales sont vivantes, elles évoluent. Les Black Studies datent des années 1970 ! Je veux bien que chaque pays ait ses spécificités mais c’est un peu dommage qu’on ne puisse pas piocher, s‘adapter, s’en servir, alors qu’on nous parle de l’école de Chicago. Pourquoi y a-t-il des choses dont on parle et se sert pour le réintroduire dans un autre contexte et d’autres qu’on laisse de côté ?
(…) On s’est dit qu’on allait partir de ceux qui ont déjà fait des choses, utiliser les savoirs de chacun. Quand on fait de la recherche, qu’est-ce qu’on fait ? On se rencontre, on parle de nos travaux, on explique la littérature trouvée et mobilisée, les adaptations ou pas, le contexte de production et pourquoi on peut ou on ne peut pas l’utiliser. C’est pour essayer de penser ces choses-là qu’on a créé cette journée. L’idée était de permettre aux étudiants, pas que de l’EHESS, mais d’un peu partout, de s’exprimer. On visait la région parisienne : mais il y a des gens de Bordeaux qui ont postulé et vont venir pour cette journée ! Cette question intéresse. L’idée de la mise en commun, de l’échange du savoir et de réunir les enseignants qui ont déjà pu, à certains moments, faire des travaux dans lesquels ils ont déblayé des choses, est fondamentalement importante. Pap Ndiaye, par exemple, avec La Condition Noire, a commencé le travail.
Cela a été un défi de rechercher les enseignants chercheurs qui avaient déjà travaillé sur ces questions. Mais plus on cherchait plus on en trouvait. »
GN : « Il y a du monde mais il n’y a pas de réseaux. Les propositions de communication qu’on a reçu, elles ont été hallucinantes : c’est intéressant et poussé, mais on ne savait pas tout ça, parce qu’on en parle pas. Il n’y a pas de groupe, de lieu d’échange, alors qu’il y a plein d’étudiants. Peut-être que c’est parce qu’on est avec des directeurs qui ne sont pas spécialisés, donc on fait son truc tout seul. On s’est donc dit qu’il fallait que tout le monde se rencontre, qu’on se rassure et que chacun s’enrichisse. »
IC : « Oui, quand tu fais de la recherche, on te dit d’aller trouver des personnes proches de toi, pour résoudre les problématiques de ton terrain avec des gens qui ont rencontré les mêmes choses, mais on a du mal : on passe notre temps avec des gens qui travaillent sur d’autres choses que la dimension raciale de notre sujet. Au moins là, pour une fois, on pourra penser comment on traite de ça, comment on peut l’analyser. »
Les deux étudiantes expriment leur désir de faire changer les choses, de repenser le regard des sciences sociales envers la légitimité du militantisme : « Ce sujet vient déligitimer ton point de vue de future chercheure donc tu ne peux pas en parler. » Elles reviennent aussi sur le modèle que peut-être l’étude des genres : les Gender Studies, qui commencent à trouver légitimation dans les sciences sociales en France et sont le parfait exemple de l’action militante et scientifique en correspondance. Les intervenantes nous décrivent tout de même un climat tendu au sein même de la communauté des chercheurs, qui les pousse à vouloir réaliser cette journée d’autant plus. Cela peut pourtant aussi, malheureusement, pousser à la réticence et à la peur de s’exprimer et de s’engager dans ce type de recherches.
Morgane Henry, Marion Atchori




